La vie a-t-elle un sens ? (Mystique et mélancolie)

Texte de Michel CAZENAVE
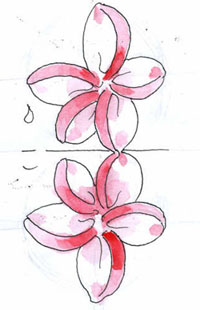
« Les choses ne se fatiguent pas d’aller et venir.
Les mouches aboutissent aux mets délicats »
Jack Kerouac
La vie a-t-elle un sens ?
Au fond, je n’en sais rien, et voici des décennies que je m’en pose la question. sans savoir qu’y répondre : je me réveille si souvent en me disant qu’elle ne doit pas en, avoir, et puis, je me couche sur le soir de la même journée en pensant que, après tout … !
Comme s’il y avait là un indécidable dont nous décidons à mesure de nos humeurs, des flux de nos croyances et des pulsions à donner foi qui nous emportent comme elles veulent.
De fait, sur un tel sujet, si essentiel au fond, si vital en fin de compte, je voudrais ici simplement livrer les impressions, les réflexions de l’écrivain que j’ai (maladroitement) essayé d’être toute ma vie – sans jamais, sans doute, y parvenir tout à fait, mais enfin, quel autre titre aurais-je à vouloir parler du sens de la vie ?
Selon mon propre style, les sauts de ma pensée et les tours rhétoriques qui peuvent être les miens.
Les expériences de Cronos
Né pour « remplacer » un frère mort, j’en ai senti l’invisible poids sur mes épaules dès ma plus tendre enfance : comme on ne me l’avait jamais vraiment caché, c’était un sort supportable, mais je n’ai jamais cru durant de longues années (si tant est que je me fusse alors posé la question, et qu’il ne s’agit pas de ma part d’une reconstruction dans l’après-coup), je ne croyais certes pas que la vie eût un sens, quel qu’il fût par ailleurs.
Ce fut encore bien pire à la sortie de l’adolescence : dans une grave crise mélancolique où le temps s’étirait indéfiniment sous le signe de Saturne et où je rêvais la nuit que ma mère, sous les traits de la déesse Kali, buvait mon sang à ma gorge dans d’horribles festins, l’odeur et le sens de la mort étaient tellement présents que la tentation du suicide se présenta plusieurs fois : autant répondre par le non-sens au non-sens de la vie, en ignorant à ce moment que la quête de la mort signifie dans ces instants l’affirmation quasi désespérée d’un sens si haut de la vie, et d’une vie sans commune mesure avec celle que nous menons d’habitude, que la fascination de la mort n’est finalement rien d’autre (et pour l’occidental que je suis : je ne suis pas Japonais, et le seppuku, quant à moi, ne m’a jamais attiré) – la fascination de la mort n’est rien que la croyance en un sens splendide et ultime de la vie.
Mais peut-être n’y croyais-je pas assez ? Même tout au bord de l’acte, parfois, je ne suis jamais passé à l’acte, de ne pas être très sûr de ce que je trouverais ensuite – ou peut-être effrayé à l’idée qu’il n’y avait strictement rien à trouver ?
Bref, je m’en sortis (par miracle ?) en tombant par hasard – par hasard et par nécessité, aurait dit Pierre Solié – sur les Métamorphoses de Jung qui m’éclairèrent largement sur ce que j’étais en train de vivre (Ah ! la brûlure au fer rouge de ces pages inoubliables sur l’inceste symbolique !) ; qui me permirent peu à peu de refaire surface comme un plongeur qui remonte des profondeurs de la mer, et me firent au moins comprendre que le nouveau sens – ou plutôt : le sens tout nouveau que je découvrais dans ma vie, n’existait justement que de s’affirmer de la sorte de l’épreuve du non-sens.
Expérience cruciale, en vérité – où s’enracina une fidélité sans faille au psychiatre de Zürich, mais qui devait se creuser tout au fil d’une existence où surgissait à chaque pas, d’interrogation en interrogation, d’étape en étape une à une parcourue, cette question qui devait tout le temps me poursuivre : mais quel peut donc bien être le sens de tout cela ?
Excursus par Zürich et les brumes de l’Écosse
De ce Carl Gustav Jung, justement, que l’on répute si bêtement de croire en un sens inhérent à la vie, je rappellerai les quelques lignes que l’on trouve dans la dernière page de Ma Vie : « Le monde dans lequel nous pénétrons en naissant est brutal et cruel, et, en même temps, d’une divine beauté. Croire à ce qui l’emportera du non-sens ou du sens est une question de tempérament (…) Comme dans toute question de métaphysique, les deux sont probablement vrais : la vie est sens et non-sens (…) J’ai l’espoir anxieux que le sens l’emportera et gagnera la bataille. » Dès que je les lus bien plus tard, ces mots résonnèrent incroyablement en moi – parce que j’y trouvais résumé le dilemme qui me torturait, et qu’ils faisaient étrangement écho aux paroles de Macbeth dans la tragédie de Shakespeare – des paroles qui m’avaient tant marqué qu’elles m’auront accompagné tout au long de ma vie : « La vie n’est qu’une ombre qui passe, un pauvre histrion qui se pavane et s’échauffe une heure sur la scène et puis qu’on n’entend plus … une histoire contée par un idiot, pleine de fureur et de bruit et qui ne veut rien dire. »
Comme je ne suis pas Faulkner, je n’en ai pas tiré de chef-d’œuvre, mais la question était là : vivons-nous une tragédie ou une comédie aussi burlesque que les cartoons de Tex Avery (et d’autant plus burlesques que le non-sens, précisément, s’y déploie sans vergogne), et si le sens doit l’emporter, ne serait-ce pas simplement la marque de l’illusion que nous nous sommes fabriquée ?
Ce qui n’a rien – et tout à voir
Parvenu à ce point, quelques citations qui me sautent à l’esprit comme un chat à la gorge :
« Hével havalim
Dit Qohélet
Tout est hével
Vent ! »
En rappelant que hével, en hébreu, c’est la vapeur, la buée, la fumée qui se dissipe – d’où le nom d’Abel dans le livre de la Genèse .
Et en remontant à l’origine de ces paroles désabusées :
« Un âge va, un âge vient, et la terre tient toujours.
Le soleil se lève et le soleil s’en va ; il se hâte vers son lieu, et là il se lève.
Le vent part au midi, et tourne au nord ; il tourne et il tourne ; et le vent reprend son parcours. »
Texte que l’on peut préférer dans une version plus récente qui – outre qu’elle nous évite le mauvais jeu de mots qui consiste à traduire Qohélet par L’Ecclésiaste en s’appuyant sur le grec kaléô – se montre beaucoup plus proche du texte d’origine et de son sens ( !) obvie :
« Une génération s’en va, une génération s’en vient, mais la terre reste.
Le soleil se lève, le soleil se couche, retournant d’où il est parti pour renaître.
Le vent souffle vers le Sud, tourne vers le Nord, il s’en va, tournoie, puis revient. »
Autrement dit, comme Héraclite nous l’avait déjà déclaré, mais comme le taoïsme ou le bouddhisme en Asie ne cessent de le rappeler, tout coule, tout change, tout s’évanouit et disparaît sous nos mains périssables.
Les sages ne reçoivent pas de récompense, les pauvres n’ont pas d’espoir (sauf peut-être dans les cieux s’ils ont la chance [ ?] d’y croire), les méchants sont au faîte, et il y a un temps pour tout – un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour rire et un temps pour pleurer …
Au fond, tout nous est incompréhensible, tout est vain à vue humaine, toutes les illusions de notre vie finiront par s’éteindre dans le bleu d’un ciel qui reste insensible à toutes nos peines et toutes nos joies.
Alors, comme le chante le psaume (mais il s’agit ici de l’abandon à une inexplicable Providence : nous y reviendrons plus tard) :
« En vain tu avances ton lever,
tu retardes ton coucher,
mangeant le pain des douleurs
quand (Yahvé) comble son bien-aimé qui dort… »
Autrement dit, à quoi bon se lever le matin ? Dieu existe peut-être, la vie a peut-être un sens sous son regard (mais Dieu a-t-il des yeux ?) : il n’en reste pas moins que tout nous est un mystère, à commencer par sa grâce et que nous avons l’impression de ne rien y comprendre :
« Je regarde encore toute l’oppression qui se fait sous le soleil : voici les pleurs des victimes et elles n’ont pas de consolateur ! (…) Alors, je félicite les morts qui sont déjà morts, plutôt que les vivants qui sont encore vivants … »
Les prédications de Nag-Hammadi
Devant de telles considérations – et comment ne pas y entendre l’écho de celles-là même qui engendrent la mélancolie quand elle atteint à son acmé ? – il ne reste logiquement que deux solutions possibles : soit le « créateur » de ce monde est un être trompeur et méchant qui nous plonge dans un désert de perdition, soit « Dieu » gouverne le bien comme le mal, il est à la source à la fois du sens et du non-sens.
La première hypothèse, celle qui se présente spontanément, à vrai dire, au plus fort de l’œuvre au noir, quand on se sent dépecé par toutes les forces qui nous assaillent, elle ne date pas d’aujourd’hui : déjà les gnostiques et, un peu plus loin, vers l’Est, les habitants de l’ancienne Perse, l’avaient pensée et mise en forme :
« Parce que ceux qui appartiennent au Tout cherchèrent à connaître celui dont ils sont issus et que le Tout était à l’intérieur de l’Inappréhendable inconcevable, lui qui est au-dessus de toute conception, c’est alors que la méconnaissance du Père se fit perturbation et angoisse. Puis la perturbation se figea à la manière d’un brouillard au point que nul ne put voir. De ce fait, l’Erreur tira sa puissance. Elle se mit à œuvrer sur sa propre matière dans le vide, ignorante de la Vérité. »
Et nous vivons dans le monde de l’erreur et du brouillard … comme le dieu que nous révérons, celui qui se dit toute bonté mais provoque le Déluge ou incite au carnage , est le prince du mensonge, il est l’avorton du vrai dieu, sa contrefaçon simiesque, le comble du non-sens qui se dégage sous l’apparence du sens :
« Il y a un voile entre ce qui est en haut et les éons d’en bas. Et une ombre exista en dessous du voile. Et cette ombre devint matière. (…) Et ce qu’elle fit fut une œuvre dans la matière, semblable à un avorton. Il reçut forme d’après l’ombre. Ce fut une bête arrogante, ressemblant à un lion. (…) Ouvrant les yeux, il vit une grande matière illimitée et devenant arrogant, il dit : « Je suis Dieu et il n’y en a pas d’autre que moi. »
Au fond, le zoroastrisme, et plus tard le manichéisme, ne penseront pas différemment – de même que Marcion en Occident, et il s’agit dès lors de se ranger parmi les fils de la lumière, soit pour assurer son salut, soit pour aider le dieu du Bien dans son combat eschatologique contre les forces des ténèbres .
L’incompréhensible de Dieu
Autre version – et l’on balance souvent dans sa vie de l’un à l’autre pôle sans savoir où se fixer (peut-être parce que, psychiquement, on les vit comme équivalents dans les tempêtes de notre âme) : Dieu est à l’origine du bien comme du mal, il détermine tout ce qui peut nous arriver, de quelque nature que ce soit, et ce qui n’a pas de sens pour nous en a sans doute un pour Lui, dont nous ne pouvons pas avoir l’intelligence.
Que l’on se souvienne à ce propos des terribles paroles de Yahvé que ressent tout déprimé profond dans la nuit de sa détresse :
« Je façonne la lumière et crée les ténèbres.
Je fais le bonheur et provoque le malheur,
c’est moi Yahvé qui fais tout cela. »
- ou de l’oracle à Baruch que l’on trouve dans Jérémie :
« Ainsi parle Yahvé. Ce que j’avais bâti, je le démolis, ce que j’avais planté, je l’arrache : je vais frapper toute la terre ! (…) Car voici que j’amène le malheur sur toute chair. »
Alors, comme l’affirme toute la tradition de la cabale, bien et mal, sens et non-sens sortent du sein insondable du haut Seigneur unique :
« La réalité universelle ne peut subsister si ce n’est grâce à des existants qui ont pour fonction de faire le bien et de faire le mal, pour maintenir et faire perdurer, et pour détruire et anéantir, pour donner une bonne rétribution et pour châtier, car « Dieu a fait en sorte qu’on le craigne (Ec, 3, 14). Et Salomon a dit : le Dieu a fait ceci face à cela » (Ibidem, 7, 14), et nos maîtres ont ajouté : « Il a créé des justes, il a créé des méchants, il a créé le jardin d’Éden, dans la poussière, il a créé la géhenne (Haguiga 15a) . »
Ici, dans notre désorientation existentielle, et devant cette terrible conjonction des opposés qui se révèle pour nous comme la réalité ultime telle qu’elle nous est saisissable, nous nous trouvons comme Job sur son tas de fumier – ce Job au sujet de qui Jung a si profondément, et parfois si vertigineusement médité .
Comme il l’exprime dans sa correspondance : « La bonté de Dieu signifie grâce et lumière, et Sa face ténébreuse la terrible tentation de la puissance . »
Allons pourtant plus loin.
La question ainsi posée hante l’humanité depuis que nous en avons des témoignages. Et si le Livre de Job est la démarque hébraïque des ces Plaintes du juste que l’on exhalait déjà dans l’antique Babylone, il n’en reste pas moins qu’il est aussi l’épreuve du non-sens humain poussé jusqu’à son terme : lorsque Dieu apparaît à Job à la fin de ses épreuves, il lui montre clairement comme il ne peut comprendre une transcendance qui le dépasse de toutes parts, il ne peut que s’incliner devant Celui qui maîtrise Béhémoth et Léviathan, il ne peut se saisir de la sagesse créatrice qui est celle de YHVH :
« As-tu, une fois dans ta vie, commandé au matin,
assigné l’aurore à son poste
pour qu’elle saisisse la terre par les bords
et en secoue les méchants ? »
Alors, dans son dés-espoir et son malheur, Job, ne peut que « rendre les armes » - comme nous nous inclinons dans notre vie lorsque tout a perdu sens et que c’est la pulsion de mort elle-même qui nous maintient en vie – il ne peut que répondre à Celui dont rien ne peut rendre compte, revenant sur ses plaintes et ses essais maladroits pour « penser » le non-sens de ce qu’il a dû endurer :
« J’ai parlé à la légère : que te répondrai-je ?
Je mettrai plutôt ma main sur ma bouche.
J’ai parlé une fois … Je ne répéterai pas ;
deux fois … Je n’ajouterai rien ! »
Avant de conclure :
« J’étais celui qui brouille tes conseils
par des propos dénués de sens.
Aussi ai-je parlé sans intelligence
de merveilles qui me dépassent et que j’ignore.
(…)
Je ne te connaissais que par ouï-dire,
mais maintenant mes yeux t’ont vu.
Aussi je retire mes paroles,
je me repens sur la poussière et sur la cendre. »
D’Israël à la Grèce
Qu’est-ce à dire toutefois ?
Que la puissance suprême nous soit strictement impensable, voilà bien un topos de toute littérature sapientale : « Tout ce que (Dieu) fait convient à son heure mais il donne (aux hommes) à considérer l’ensemble du temps, sans qu’on puisse saisir ce que Dieu fait du début à la fin. » Autrement dit, même si nous avons le « sens » de l’éternité et que nous nous approprions le présent, cela ne nous révèle pas le sens de la vie.
D’où, la prudence nécessaire de qui veut déchiffrer ce sens qui se dérobe : « Ne te presse pas d’ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas de parler aux Elohim, car ils sont au ciel et toi sur terre. Donc, parle peu… »
Ce qui en revient peu ou prou à la parole d’Héraclite sous son aspect scandaleux : « Pour dieu, tout est bon et beau et juste ; les hommes tiennent certaines choses pour justes, les autres pour injustes. » - et à cette profession de foi que tout, du sens ultime, dépend de la manière dont nous le percevons nous-mêmes – du moins dans sa manifestation : « Dieu est jour et nuit, hiver et été, guerre et paix, satiété et faim ; mais il change comme le feu, quand il est mélangé d’aromates, et nommé suivant le parfum de chacun d’eux. »
Le sens du non-sens
Tout cela, un mélancolique l’a bien « compris » - plus, il en a fait l’expérience la plus intime et douloureuse : il sait bien que, derrière tout sens commun, se cache un non-sens fondamental, que rien n’a de sens dans la vie, que tout a l’odeur de la mort, que nous ne venons au monde que pour en disparaître plus tard, et que c’est l’épreuve du non-sens qui est la suprême vérité.
Ou du moins le croit-il. Au cours de son chemin.
Car, s’il a le courage d’aller jusqu’au bout – ou qu’une puissance « tutélaire » le guide ainsi malgré lui – il découvre soudain que c’est précisément le non-sens, cet au-delà de tout mot, de toute image, de toute intelligence, de toute connaissance possible, qui préside au sens le plus vrai que puisse acquérir sa vie.
Comme si la plénitude ne se pouvait révéler que dans l’affrontement au vide le plus abyssal qui soit : mais une plénitude qui ne sera jamais pleine, une plénitude sans cesse en voie de réalisation, un sens qui ne cesse d’appeler, de se « définir » comme la négation du non-sens – et dans cette négation, comme son enfant légitime.
En d’autres termes, nous ne comprendrons jamais rien, nous manquerons toujours de l’Absolu, et c’est ce manque essentiel qui nous donne notre orient, de nous faire marcher vers lui comme vers cet indépassable horizon qui toujours se dérobe en s’offrant pourtant toujours.
Sans le rien, existerait-il quelque chose ? Sans le non-sens, pourrions-nous parler du sens ? Pourrions-nous seulement le « penser » - fût-ce négativement ?
Pour ne pas citer Jung, c’est à Héraclite que je me référerai encore une fois : « On ne saurait même pas le nom de la justice s’il n’y avait pas d’injustices » ; et surtout cette phrase : « Le nom de l’arc est vie, son œuvre mort » - qui joue sur le mot bios en grec, un mot dont on sait que, selon l’accentuation qu’on lui donne, soit sur l’omicron, soit sur l’iota, il signifie l’arc, « ce qui donne la mort », ou il signifie la vie : comme si la vie sortait de la mort, que la vie authentique était sculptée par la puissance de la mort, que toute découverte de l’esprit passait par l’œuvre au noir – par le démembrement de soi-même afin qu’apparaisse l’homme, je veux dire l’être humain nouveau.
L’apophatisme du sens
Je ne veux pas me livrer ici à des études de religion comparée qui m’entraîneraient beaucoup trop loin. Mais nous voyons bien que, de toutes les manières possibles, nous nous mouvons aux frontières de cette inexprimable expérience qu’ont parfaitement repérée toutes les théologies négatives : le plein est vide de sens ; c’est le vide et l’au-delà du vide qui le découvrent au contraire dans toute sa plénitude :
« L’être (de la Vie véritable) est inaccessible à la connaissance. Si donc la Nature vivifiante transcende la connaissance, ce qui est saisi par l’esprit n’est aucunement la Vie. Or ce qui n’est pas la Vie n’est pas apte à communiquer la Vie. Donc ce (qu’il) désire s’accomplit (pour Moïse) par là même que son désir demeure inassouvi. »
Jusqu’aux gnostiques, devant que de dérouler leur somptueuses hiérarchies d’éons, posaient un inconcevable premier : l’inappréhendable inconcevable, disait l’Évangile de la vérité. Et le Traité tripartite :
« Celui qui n’est concevable par aucune pensée, qui n’est visible en aucune chose, qu’aucune parole ne peut dire, qu’aucune main ne peut toucher, c’est lui seul qui se connaît lui-même tel qu’il est, (…) lui l’Inconcevable indicible, insaisissable et immuable. »
Trouver le sens, alors, ce n’est pas ignorer ou éviter le non-sens, c’est trouver ce dernier en soi, c’est le dépasser en le niant après l’avoir éprouvé jusqu’au fond de son cœur (la négation de la négation de saint Thomas d’Aquin comme de maître Eckhart ), c’est retrouver le monde au cœur même et au bout du processus de dépossession du moi :
« Dès ce moment qu’il ne connaît plus rien, (l’homme) est élevé au-dessus de son entendement en connaissant au-delà de sa connaissance. »
Ou comme l’exprimait cet admirable mystique du XIVe siècle allemand : « Qu’est-ce que l’exercice d’un homme bien abandonné ? C’est de se défaire. »
Le sens de l’amour
Entendons-nous bien cependant : je ne confonds pas mystique et psychopathologie, mais, comme Jung à Eranos , je me vois obligé de faire appel à ces deux domaines pour tenter de me faire entendre. Et de faire comprendre que c’est peut-être dans la dépression la plus grave (avec tous les risques qu’elle comporte), que se découvre – ou que s’invente – ou bien les deux à la fois - un sens de la vie qui ne soit pas de l’illusion, et qui assure les deux significations de ce mot : une signification de la vie, précisément, qui ne se donne en fin de compte que dans l’indéfinissable direction qu’elle prend vers un horizon sans bord.
Maintenant, si je voulais être complet, je devrais dire que ce sens, comme Jung le pointe à la fin de Ma Vie, avec référence explicite à l’abandon de Job , ce sens hors de tout sens, ce sens à la lettre insensé (du moins selon l’opinion de ceux qui se croient sensés – on peut lire de la sorte la sentence du Qohélet dès l’instant qu’on s’est livré à ce renversement du sens : « Quand l’insensé marche sur une route, le sens lui manque et il dit de chacun : « voilà un fou ! » » - mais l’insensé est ici l’homme commun dans son « bon sens »), ce sens royal et pourtant hors de toute saisie possible, ce sens incessant dans sa marche, dans sa nouveauté toujours première, dans le total imprévisible de sa singularité, il ne survient jamais que dans la puissance entraînante, dans la dynamis reconnue, admise, assumée ( ?), de l’eros cosmogonique, de l’amour sans condition : (l’homme) « peut donner à l’amour tous les noms possibles et imaginables dont il dispose, il ne fera que s’abandonner à des illusions sans fin sur lui-même. S’il possède un grain de sagesse, il déposera les armes et l’appellera ignotum per ignotius – une chose ignorée par une chose encore plus ignorée, - c’est-à-dire du nom de Dieu. »
Mais ceci est une autre histoire, et on ne peut sans doute rien en dire : « L’homme qui a accédé à la vraie lumière,/ quelle est son existence ? – On ne peut pas le dire exactement. – Pourquoi cela ? – Celui qui n’y a pas accédé, ne peut le dire. / Celui qui y a accédé, ne peut le dire non plus… / C’est pourquoi : qui veut le savoir, qu’il attende d’accéder lui-même à cette lumière ! »
Et comme j’ai commencé cet article par quelques mots de Kerouac, qu’on me permette de finir de même :
« La cause du malheur du monde est la naissance. Le remède au malheur du monde est une baguette courbe. »
Comprenne qui pourra, et y trouve son sens celui qui en est digne !